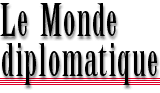 |
|

|
|
|
|
|
Les 7 Etats qualifiés par les Etats-Unis de commanditaires du terrorisme
Extrait du Rapport sur le terrorisme dans le monde 2001 du département d'Etat américain : Vue d'ensemble du terrorisme commandité par les États« Chaque pays, sur chaque continent, doit maintenant prendre une décision : soit il est avec nous, soit il est avec les terroristes. » Le président George Bush Le 20 septembre 2001, dans son discours sur l'état de l'Union, le président Bush a lancé aux États qui soutiennent le terrorisme l'avertissement suivant : « Chaque pays, sur chaque continent, doit maintenant prendre une décision : soit il est avec nous, soit il est avec les terroristes. » Les sept États désignés comme commanditaires du terrorisme, à savoir la Corée du Nord, Cuba, l'Iran, l'Irak, la Libye, le Soudan et la Syrie, ont clairement entendu le message du président. Si certains d'entre eux semblent être en train de reconsidérer leur ligne d'action, aucun n'a encore pris les mesures pour se défaire entièrement des liens avec le terrorisme. Le Soudan et la Libye paraissent les plus à même de comprendre ce qu'ils doivent faire pour renoncer à la pratique du terrorisme, et ils ont agi dans ce sens. L'Iran, la Corée du Nord et la Syrie ont pris, dans des domaines très restreints, des mesures limitées pour coopérer avec la campagne de la communauté internationale contre le terrorisme. Cependant, l'Iran et la Syrie cherchent à gagner sur les deux fronts. D'un côté, ils ont sévi contre certains groupes terroristes, dont Al-Qaïda. D'un autre côté, ils ont maintenu leurs liens avec d'autres réseaux terroristes, notamment le Hamas et le Hezbollah, affirmant qu'il s'agit de mouvements de libération nationale. La Corée du Nord, qui a initialement bien réagi, a brusquement mis fin à ses efforts. Tant que tous les États qui commanditent ou tolèrent le terrorisme ne changeront pas de cap, que ce soit de leur propre gré ou par coercition, ils demeureront une base fondamentale pour les groupes terroristes et leurs opérations. Même si, en 2001, on a constaté la poursuite de la tendance vers la diminution du rôle des États comme force directrice de la menace terroriste globale, les États parrains du terrorisme représentent un obstacle majeur à la campagne internationale contre le terrorisme. Dans certaines régions, notamment Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza, les États commanditaires du terrorisme demeurent une force de soutien importante du terrorisme. L'Iran continue d'appuyer fermement le Hezbollah, le Hamas et le Djihad islamique palestinien. L'Irak recourt au terrorisme contre les groupes dissidents irakiens opposés au régime de Saddam Hussein. La Syrie a maintenu son appui au Hezbollah et a autorisé le Hamas, le Djihad islamique palestinien et autres groupes palestiniens opposés aux négociations avec Israël à garder des bureaux à Damas. Cuba - Depuis le 11 septembre, Fidel Castro a hésité sur l'attitude à adopter à l'égard de la guerre contre le terrorisme. En octobre, il a qualifié la guerre menée par les États-Unis contre le terrorisme de « pire que l'attaque initiale, d'acte militariste et fasciste ». Lorsqu'il a constaté que cette attitude lui attirait plus de critiques que d'éloges, il a pris des mesures pour démontrer le soutien de Cuba à la campagne internationale antiterroriste et signé les douze conventions de l'ONU contre le terrorisme, ainsi que la déclaration ibéro-américaine sur le terrorisme adoptée lors du sommet de 2001. Certes Cuba a décidé de ne pas critiquer la détention d'individus soupçonnés d'activités terroristes à la base navale américaine de Guantanamo, mais il a continué de dénoncer les mesures prises à l'échelle mondiale contre le terrorisme, allant jusqu'à affirmer que les États-Unis visaient sciemment des enfants afghans et des hôpitaux de la Croix-Rouge. Nonobstant la signature des conventions de l'ONU contre le terrorisme, Fidel Castro n'a pas cessé de considérer le terrorisme comme une tactique révolutionnaire légitime. Le gouvernement cubain a continué d'autoriser au moins vingt membres de l'ETA basque à résider à Cuba en tant qu'invités privilégiés, et a offert refuge et appui aux membres des FARC et de l'ELN colombiens. En août, un porte-parole du gouvernement cubain a révélé qu'un représentant officiel du Sinn Fein auprès de Cuba et de l'Amérique latine, M. Niall Connolly, qui est l'un des trois membres de l'Armée républicaine irlandaise arrêtés en Colombie parce qu'on le soupçonnait d'avoir entraîné des membres des FARC au maniement des explosifs, avait séjourné à Cuba pendant cinq ans. De plus, la récente arrestation au Brésil d'un chef d'un groupe terroriste chilien, le Front patriotique Manuel Rodriguez (FPMR), laisse à penser que, durant les années 90, le gouvernement cubain a abrité des terroristes du FPMR recherchés pour meurtre au Chili. Le terroriste appréhendé a déclaré aux autorités brésiliennes qu'il était passé par Cuba pour se rendre au Brésil. Après une évasion de prison, en 1996, les enquêteurs chiliens ont retracé des appels de la famille chilienne des membres du FPMR à Cuba, mais le gouvernement cubain a refusé deux fois les demandes d'extradition, affirmant que les personnes en question n'étaient pas à Cuba et que les numéros de téléphone étaient incorrects. De nombreux fugitifs américains ont continué de vivre à Cuba, notamment Joanne Chesimard, recherchée aux États-Unis pour l'assassinat, en 1973, d'un agent de police du New Jersey. Mme Chesimard est l'invitée du gouvernement Castro depuis 1979. Iran - L'Iran est resté en 2001 l'un des parrains les plus actifs du terrorisme. Le Corps des gardes de la révolution islamique (IRGC) et le Ministère du renseignement et de la sécurité (MOIS) sont restés impliqués dans la planification et le soutien de divers groupes qui utilisent le terrorisme pour parvenir à leurs fins. Si certains en Iran souhaitent mettre fin à cette politique, les irréductibles qui tiennent les rênes du pouvoir continuent de déjouer toutes les démarches entreprises pour y mettre fin. Depuis le déclenchement de l'« intifadah », le soutien aux groupes palestiniens qui recourent à la violence contre Israël s'est intensifié. Il semble cependant qu'au cours de l'année dernière, l'Iran ait réduit son implication dans d'autres formes de terrorisme. Il n'existe notamment aucune preuve de l'implication de l'Iran dans les attaques du 11 septembre contre les États-Unis. Il ne semble pas non plus que l'Iran ait eu connaissance de ces attaques à l'avance. Le président Khatami a condamné les attaques et offert ses condoléances au peuple américain. Durant l'année 2001, l'Iran a cherché à encourager les activités anti-israéliennes en augmentant son soutien aux groupes terroristes visant Israël. Le chef suprême Khamenei a continué de qualifier Israël de « tumeur cancéreuse » qu'il faut extraire. Joignant le geste à la parole, l'Iran a continué de financer, d'abriter, de former et d'armer le Hezbollah et les groupes palestiniens hostiles à Israël, notamment le Hamas, le Djihad islamique palestinien et le FPLP-Commandement général. L'Iran a également encouragé le Hezbollah et ces groupes palestiniens à coordonner leur planification et à intensifier leurs activités. L'Iran a en outre fourni un appui limité à des groupes terroristes dans le Golfe, en Afrique, en Turquie et en Asie centrale. Ce soutien est cependant considérablement moins important que celui qui est offert aux groupes d'opposition à Israël, et diminue depuis plusieurs années. Le gouvernement iranien n'a pas participé directement à l'application de la « fatwa » de l'Ayatollah Khomeini contre Salman Rushdie, mais ce décret n'a pas été révoqué, pas plus que la récompense de 2,8 millions de dollars offerte pour la mort de M. Rushdie. De plus, lors de l'anniversaire de ce décret, en février, certains Iraniens conservateurs ont souligné que la « fatwa » était irrévocable et devait être appliquée. Durant l'opération Liberté immuable, Téhéran a informé les États-Unis que si un avion américain s'écrasait en Iran, les forces iraniennes aideraient les équipages en détresse conformément aux conventions internationales. Lors de la conférence tenue à Bonn en 2001, l'Iran a coopéré avec les États-Unis et leurs alliés à la création de l'Autorité afghane intérimaire. L'Iran a en outre promis de fermer ses frontières avec l'Afghanistan et le Pakistan afin d'empêcher l'infiltration de talibans et de membre d'Al-Qaïda. Certains rapports affirment cependant que des Afghans arabes, notamment des membres d'Al-Qaïda, ont utilisé l'Iran comme lieu de transit pour entrer en Afghanistan ou en sortir. Irak - L'Irak est le seul pays arabo-musulman qui n'a pas condamné les attaques perpétrées le 11 septembre contre les États-Unis. Le 11 septembre, un commentateur de la station de radio officielle irakienne a déclaré que l'Amérique récoltait « les fruits de ses crimes contre l'humanité ». Ensuite, lorsque les États-Unis ont frappé l'Afghanistan, divers éditoriaux publiés dans un journal dirigé par le fils de Saddam Hussein ont exprimé leur sympathie pour Oussama ben Laden. En outre, le gouvernement a continué d'offrir une formation et des encouragements politiques à de nombreux groupes terroristes, même si sa principale cible est demeurée l'activité des dissidents irakiens à l'étranger. L'Irak a fourni des bases à plusieurs groupes terroristes, notamment l'Organisation Moudjahidine-e Khalq (MEK), le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), le Front de libération de la Palestine (FLP) et l'Organisation Abou Nidal (OAN). En 2001, le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) a fait parler de lui en Cisjordanie et dans la bande de Gaza en perpétrant plusieurs attaques terroristes réussies contre des cibles israéliennes. Conscient du rôle croissant du FPLP, le vice-président irakien a rencontré le secrétaire de cette organisation, le général Habbash, à Bagdad en janvier 2001, et exprimé le soutien continu de l'Irak à l'« intifada ». En outre, à la mi-septembre, une délégation de hauts responsables du FPLP a rencontré le premier ministre adjoint irakien. Bagdad a également continué d'accueillir d'autres groupes palestiniens opposés aux négociations avec Israël, notamment le Front arabe de libération et l'Organisation du 15 mai. Pendant ce temps, la police tchèque a continué d'assurer la protection du bureau de « Radio Free Europe/Radio Liberty », à Prague. Il s'agit d'une station de radio financée par le gouvernement des États-Unis qui produit des programmes intitulés « Radio Free Iraq » et emploie des journalistes expatriés. En 1999 et 2000, la présence policière a été renforcée du fait de divers rapports faisant état de représailles éventuelles des services irakiens du renseignement du fait des émissions de Radio Free Europe critiquant le régime irakien. En 2000, l'inquiétude au sujet de la sécurité de ce bureau a monté d'un cran et, en avril 2001, les autorités tchèques ont expulsé un agent irakien du renseignement. Les autorités irakiennes n'ont pas satisfait à la demande de Riyad visant l'extradition de deux Saoudiens qui avaient en 2000 détourné sur Bagdad un avion de la « Saoudi Arabian Airlines ». Faisant fi de leurs obligations en vertu du droit international, elles ont accordé l'asile politique aux pirates de l'air et leur ont donné toute latitude pour exprimer dans la presse irakienne (contrôlée par le gouvernement) et dans les médias internationaux leurs griefs relatifs aux divers abus dont ils accusent le gouvernement saoudien. Libye - Après les attaques terroristes du 11 septembre, le chef de l'État libyen, M. Mouammar Kadhafi, a diffusé un communiqué dans lequel il condamnait ces attentats qualifiés d'abominables et sanglants et exhortait les Libyens à donner du sang pour les victimes américaines. Le 16 septembre, il a déclaré que les États-Unis étaient justifiés dans leur droit de représailles contre les attaques. Depuis le 11 septembre, M. Kadhafi a dénoncé le terrorisme à plusieurs reprises. Il semble que la Libye ait restreint son appui au terrorisme international, même si elle maintient des vestiges de contact avec quelques groupes. Depuis quelques années, Tripoli cherche à se refaçonner en artisan de paix en proposant ses services de médiation dans plusieurs conflits tels que l'affrontement entre l'Inde et le Pakistan qui a débuté en décembre 2001. En octobre, la Libye a versé une rançon pour la libération d'un otage détenu par le groupe Abou Sayyaf, tout en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une rançon mais d'une contribution pour « aide humanitaire ». Le bilan passé de la Libye en matière de terrorisme continue de gêner les efforts que déploie M. Kadhafi en vue de débarrasser son pays de son statut de paria. En janvier, un tribunal écossais a reconnu l'agent de renseignement libyen Abdel Basset Ali al-Megrahi coupable de meurtre pour avoir, en 1988, placé à bord de l'avion du vol 103 de la Pan Am un engin explosif dont la détonation a causé la mort des 259 passagers et membres de l'équipage ainsi que celle de 11 personnes au sol à Lockerbie en Ecosse. Les juges ont conclu que Megrahi avait agi « pour favoriser les objectifs (...) des services de renseignement libyens ». Son coaccusé, l'employé de « Libyan Arab Airlines » Al-Amin Khalifa Fhima, a été acquitté parce que l'accusation n'a pas réussi à établir sa complicité « au-delà de tout doute raisonnable ». Fin 2001, la Libye n'avait toujours pas satisfait pleinement à toutes les exigences du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de cette affaire, puisqu'elle n'avait ni accepté la responsabilité des actes de ses agents officiels, ni dévoilé tout ce qu'elle savait sur l'affaire, ni versé des indemnités correctes aux familles des victimes. Les hésitations de la Libye étaient peut-être dues au fait qu'elle espèrait encore l'annulation, après appel, de la condamnation de Megrahi. (Le 14 mars 2002, une cour d'appel écossaise a maintenu cette condamnation.) En novembre, un tribunal allemand a reconnu coupables quatre personnes accusées d'avoir exécuté l'attentat à la bombe de 1986 contre la discothèque La Belle à Berlin-Ouest. En prononçant le verdict, le juge a déclaré que l'attentat avait été orchestré par des responsables du gouvernement libyen. Au vu de ce jugement, les autorités allemandes ont demandé à la Libye d'accepter la responsabilité de l'attentat et de verser des indemnités aux victimes. L'explosion a tué deux soldats américains ainsi qu'un civil turc, et a blessé plus de 200 personnes. Corée du Nord - La réaction de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) aux efforts internationaux de lutte contre le terrorisme a été décevante. Dans une déclaration diffusée après les attaques du 11 septembre, la RPDC a réaffirmé sa politique d'opposition au terrorisme et à tout appui au terrorisme. Elle a également signé la Convention des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme, accédé à la Convention contre la prise d'otages et fait part de son intention d'en signer cinq autres. Cependant, malgré l'insistance de la communauté internationale, la Corée du Nord n'a pris aucune mesure d'importance en vue de participer à la campagne antiterroriste et, notamment, n'a répondu ni aux demandes d'informations sur les dispositions qu'elle aurait prises en application des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ni aux offres de discussion sur le terrorisme faites par les États-Unis. De même, elle n'a annoncé aucune mesure visant à rechercher et à bloquer les avoirs financiers de groupes terroristes, ainsi que le demandait la résolution 1373 du Conseil de sécurité. Par ailleurs, elle n'a réagi favorablement ni à l'appel de la Corée du Sud à reprendre le dialogue, à l'ordre du jour duquel figure notamment la lutte antiterroriste, ni à l'invitation des États-Unis d'engager un dialogue concernant l'amélioration de l'application du cadre convenu. Examiné à la lumière de l'appel du président Bush à reconnaître le lien dangereux qui existe entre les armes de destruction massive et le terrorisme, ce dernier manquement est particulièrement inquiétant, vu ses implications relatives à la mise au point et à la prolifération d'armes nucléaires. De surcroît, l'accord de l'asile, par Pyongyang, à quatre membres restants de la Ligue communiste japonaise-Faction Armée rouge, qui avaient participé en 1970 au détournement d'un vol de la « Japanese Airlines » vers la Corée du Nord demeure préoccupant sur le plan de l'appui au terrorisme. Il existe en outre divers éléments de preuve laissant à penser que la RPDC a peut-être vendu des quantités limitées d'armes de petit calibre à des groupes terroristes au cours de l'année 2001. Soudan - Le dialogue sur la lutte antiterroriste qui avait débuté vers le milieu de l'an 2000 entre les États-Unis et le Soudan s'est poursuivi et même intensifié en 2001. Le Soudan a condamné les attaques du 11 septembre et s'est engagé à combattre le terrorisme et à coopérer pleinement avec les États-Unis dans la campagne de lutte contre le terrorisme. Les autorités soudanaises ont accéléré leur coopération antiterroriste avec divers organes fédéraux des États-Unis et ont arrêté des extrémistes soupçonnés de participation à des activités terroristes. À la fin de septembre 2001, les Nations unies ont reconnu les mesures positives prises par le Soudan contre le terrorisme en levant leurs sanctions contre ce pays. Le Soudan reste cependant désigné comme un État qui parraine le terrorisme. Plusieurs groupes terroristes internationaux, notamment Al-Qaïda, le Djihad islamique égyptien, Al-Gama Al-Islamiyya d'Égypte, le Djihad islamique palestinien et le Hamas ont continué d'opérer à partir du Soudan, principalement dans le cadre d'activités liées à la logistique et à d'autres types de soutien. Les supputations parues dans la presse quant à l'importance de la coopération du Soudan avec les États-Unis ont dû inciter certains éléments terroristes à quitter le pays. Les sanctions unilatérales des États-Unis à l'encontre du Soudan sont restées en vigueur. Syrie - Le président de la Syrie, M. Bashar al-Assad, et ses principaux collaborateurs ont publiquement condamné les attaques du 11 septembre. Le gouvernement syrien a également coopéré avec les États-Unis et avec d'autres gouvernements étrangers aux fins d'enquêtes sur Al-Qaïda et sur d'autres groupes ou individus liés au terrorisme. Le gouvernement syrien n'a été directement impliqué dans aucun acte terroriste depuis 1986, mais il a continué en 2001 à fournir un asile et un appui logistique à plusieurs groupes terroristes. Le Front populaire de libération de la Palestine d'Ahmad Jibril - commandement général (FPLP-CG), le Djihad islamique palestinien (DIP), le Fatah-Intifada d'Abou Moussa, le Front populaire pour la libération de la Palestine de Georges Habash, et le Hamas ont gardé des bureaux à Damas. La Syrie a offert au Hezbollah, au Hamas, au FPLP-CG, au DIP et à d'autres organisations terroristes un refuge et des installations dans la vallée de la Bekaa au Liban, qui demeure sous contrôle syrien. Damas a toutefois respecté dans l'ensemble son accord antiterroriste de septembre 2000 avec Ankara, et notamment son engagement de 1998 à ne pas soutenir le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). La Syrie a servi de pays principal de transit des armes fournies par l'Iran au Hezbollah. Elle a continué d'appliquer sa politique de longue date visant à prévenir toute attaque contre Israël ou contre des cibles occidentales à partir de son territoire ainsi que toute attaque contre des intérêts occidentaux sur son territoire. Parrains du terrorisme : les implicationsLa désignation d'un pays comme fournisseur d'une aide répétée au terrorisme international (son inscription sur la « liste du terrorisme ») entraîne l'imposition de quatre catégories principales de sanctions des États-Unis : 1. l'embargo sur les exportations et ventes à ce pays liées à l'armement, 2. l'application de restrictions aux exportations à ce pays d'articles à double usage, exigeant la notification dans les 30 jours au Congrès des exportations de biens ou de services qui pourraient accroître notablement les capacités militaires du pays ou son aptitude à soutenir le terrorisme, 3. l'interdiction de l'aide économique, 4. enfin, l'application de diverses restrictions financières et autres, notamment :
Le terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN)Les attaques perpétrées le 11 septembre contre le « World Trade Center » et le Pentagone confirment la détermination et la capacité des terroristes à élaborer, organiser et exécuter des attentats très meurtriers. À la suite de ces attaques sans précédent, les terroristes pourraient chercher, de plus en plus, à recourir à des produits chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (CBRN) - dont beaucoup sont extrêmement meurtriers - pour provoquer des catastrophes rivalisant avec celles du 11 septembre. Il est toujours possible, par divers moyens, de se procurer de tels produits, accompagnés des informations techniques sur la façon de les fabriquer et de les utiliser. Oussama Ben Laden a affirmé que l'acquisition d'« armes de destruction massive » était un « devoir religieux », et il a menacé de recourir à de telles armes. Les informations selon lesquelles des documents trouvés dans des installations d'Al-Qaïda, en Afghanistan, contiennent des renseignements sur des produits CBRN confirment les déclarations de Ben Laden. La menace ne se limite pas à ce dernier ou à Al-Qaïda. Il apparaît qu'un nombre petit, mais grandissant, d'autres groupes terroristes souhaiteraient acquérir et utiliser des produits CBRN. L'emploi par le Hamas de poisons et d'insecticides comme enduits de ferraille dans les engins explosifs artisanaux en est un exemple. L'existence en Italie d'un groupe, récemment arrêté, qui possédait un composé capable dans certaines circonstances de produire du gaz de cyanure d'hydrogène (HCN), et chez qui on a découvert des plans des canalisations souterrainnes du quartier de l'ambassade des États-Unis, illustre, elle aussi, l'intention des terroristes de recourir aux produits CBRN. Les cas de terrorisme CBRN ont généralement impliqué, jusqu'ici, des moyens artisanaux et improvisés dont l'efficacité est assurée quoique limitée. Les produits meurtriers utilisés dans certains cas (à l'exception du bacille du charbon aux États-Unis) sont eux aussi de fabrication artisanale. Dans certains autres cas on a eu recours à divers produits (produits industriels toxiques, poisons, insecticides, matières de source radiologique incorporées dans des instruments de mesure légitimes, etc.) obtenus légalement ou illégalement et utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils avaient été conçus. Bien que les actions terroristes ayant recours à ces produits et à leurs vecteurs artisanaux puissent être fort meurtrières et entraîner des dommages et des bouleversements considérables, leurs effets n'ont rien de comparable avec ceux que pourraient avoir des actes terroristes employant des versions militaires d'armes de destruction massive et leurs vecteurs. Déjà l'un des piliers de longue date de la sécurité nationale, la prévention de la prolifération des armes de destruction massive et des produits et techniques y relatifs a acquis une urgence mondiale particulière après le 11 septembre. Dans son discours du 29 janvier 2002 sur l'état de l'Union, le président Bush a déclaré que l'un des deux objectifs principaux des États-Unis était « d'empêcher les terroristes et les gouvernements qui cherchent à se doter d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires de menacer les États-Unis et le monde ». Des pays du monde entier se sont unis aux États-Unis pour exiger que l'on redouble d'efforts afin de prévenir l'acquisition par les terroristes d'armes de destruction massive et des produits et techniques y relatifs. Au sein des institutions multilatérales appropriées de non-prolifération et d'autres instances internationales, les États-Unis cherchent à encourager tous les pays du monde à adopter une politique et des programmes de non-prolifération plus musclés, afin que les terroristes, ou les États qui les parrainent et les appuient, se trouvent dans l'impossibilité d'acquérir des armes de destruction massive et des produits et techniques y relatifs. La participation active des milieux de la non-prolifération aux États-Unis et ailleurs vient renforcer utilement l'action de la coalition internationale dans la guerre contre le terrorisme. De telles activités de coopération devraient contribuer à soutenir les stratégies internationales existantes de lutte antiterroriste et les programmes de répression du terrorisme CBRN qui sont déjà normalement entrepris dans les domaines de la diplomatie, de l'échange de renseignements, des accords de coopération en matière de répression policière, des transferts de techniques, et de la sécurité et de la protection des forces, ainsi que de la formation.
|